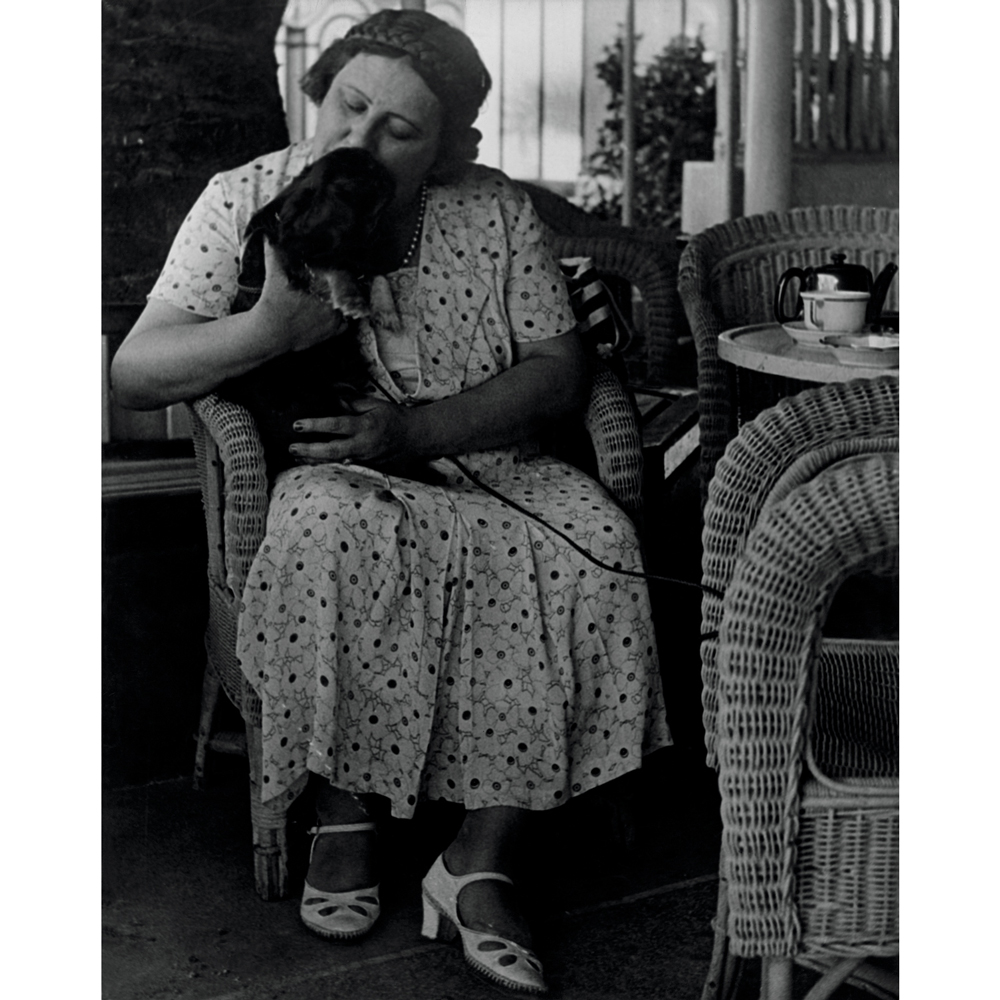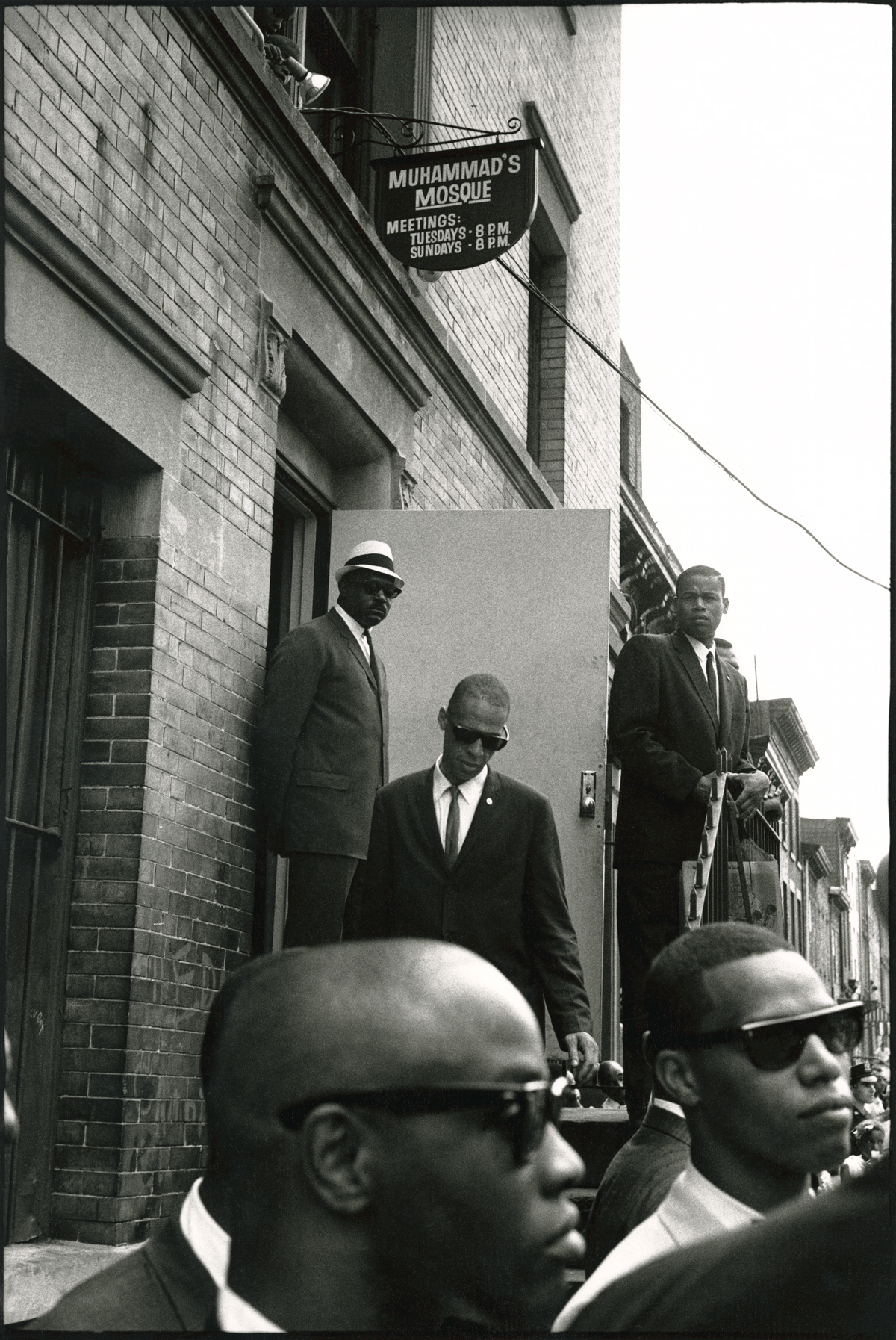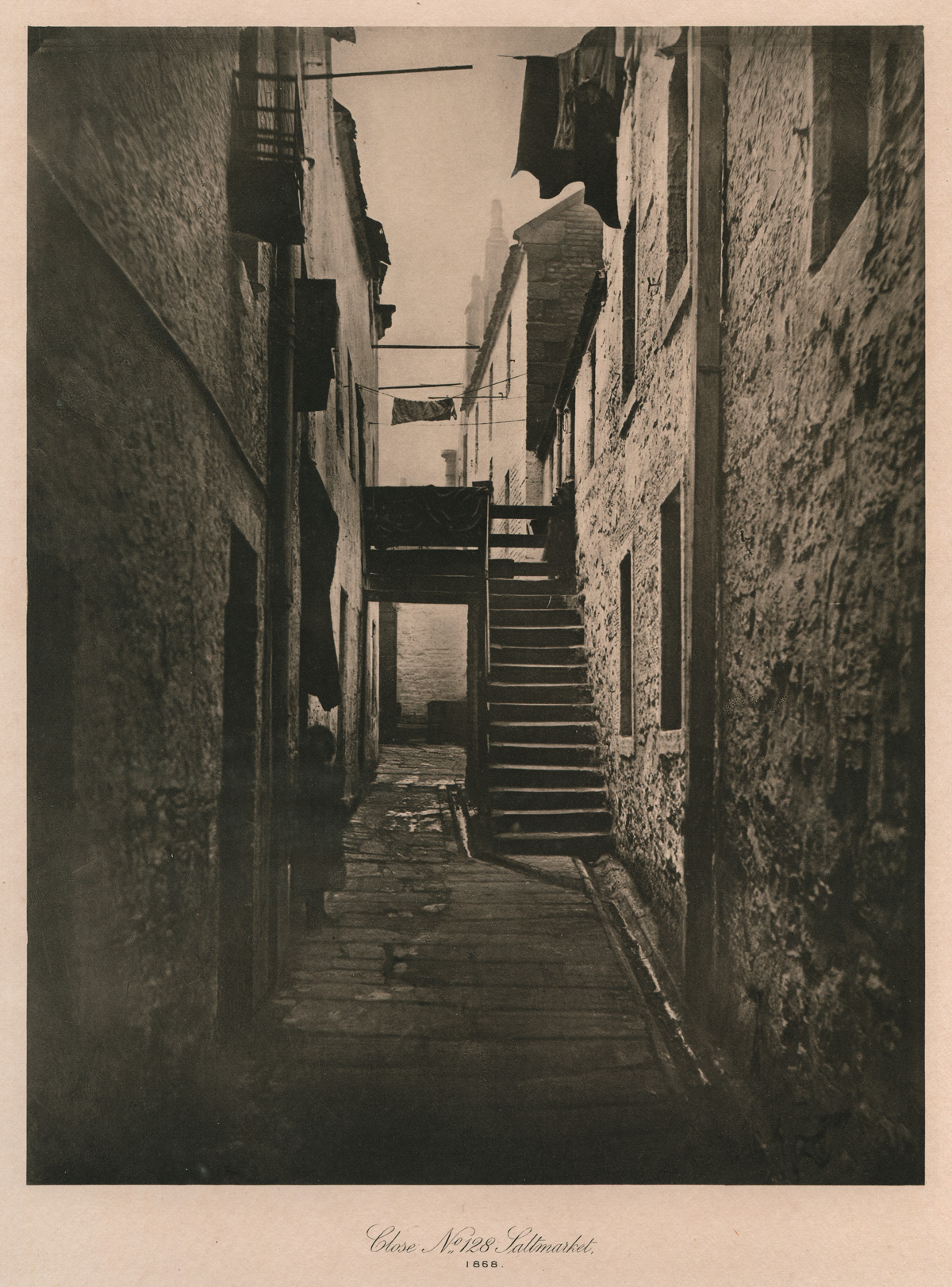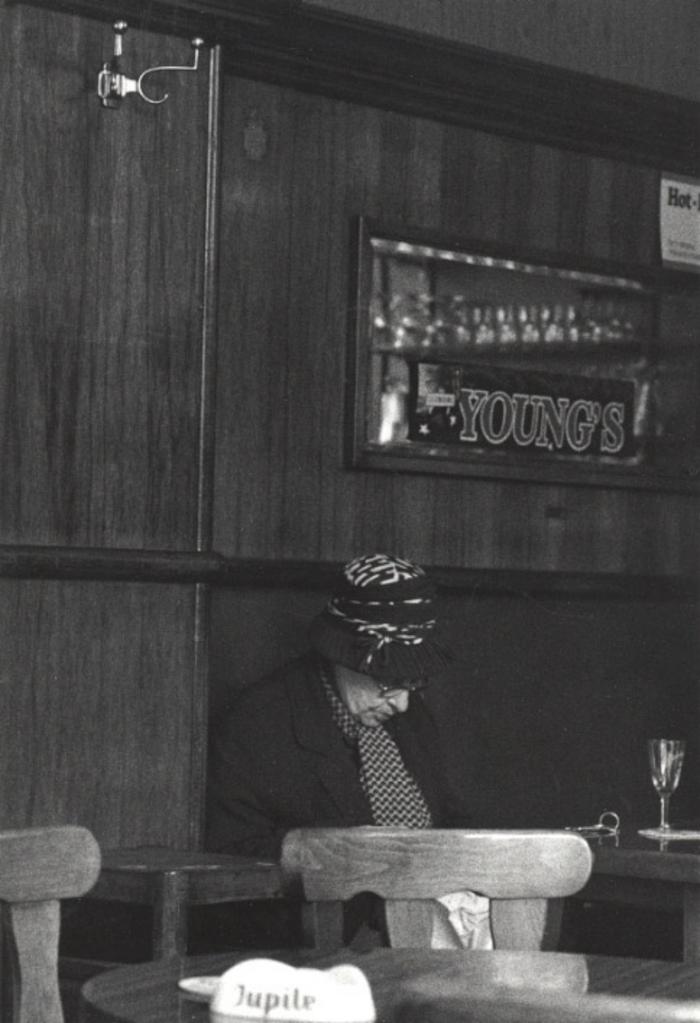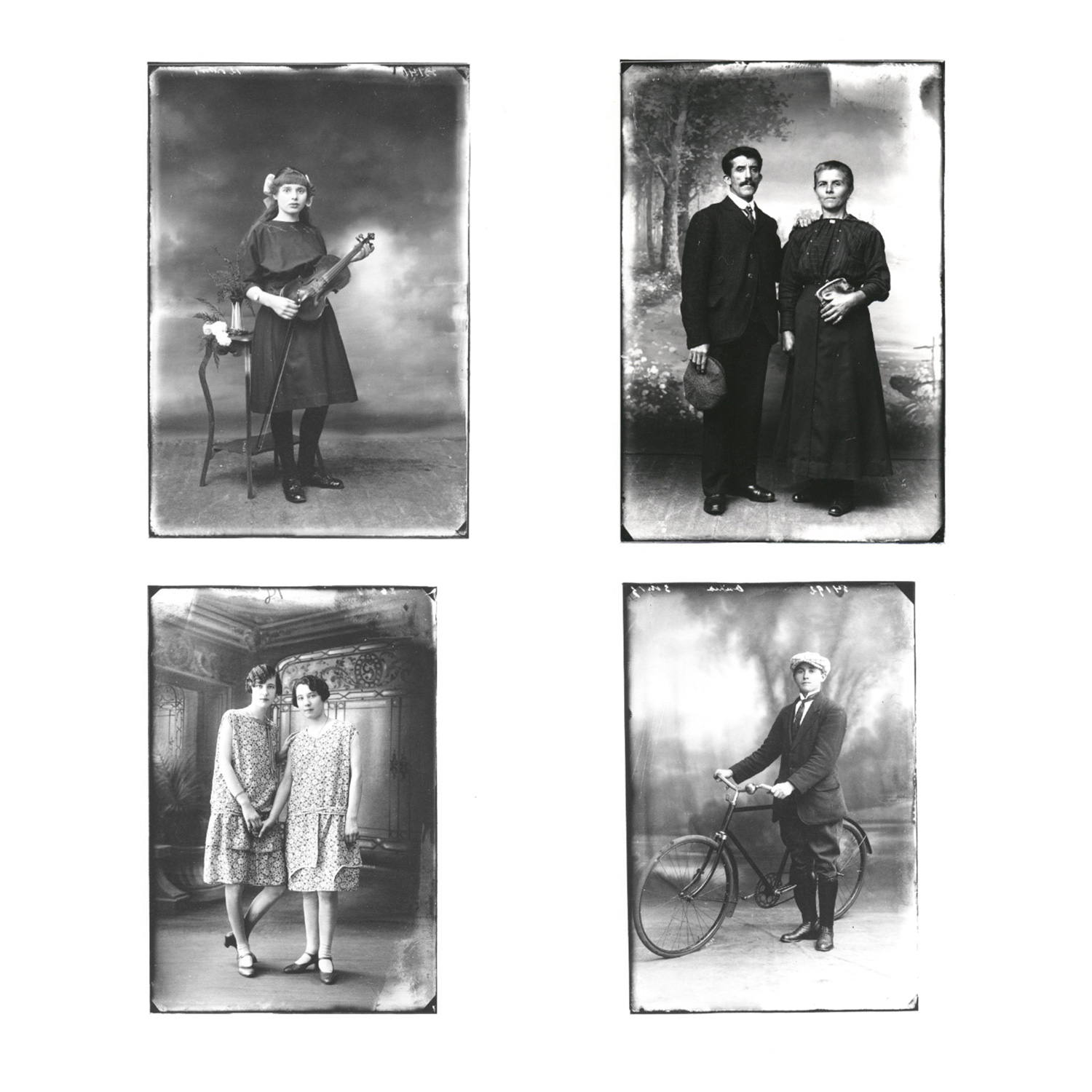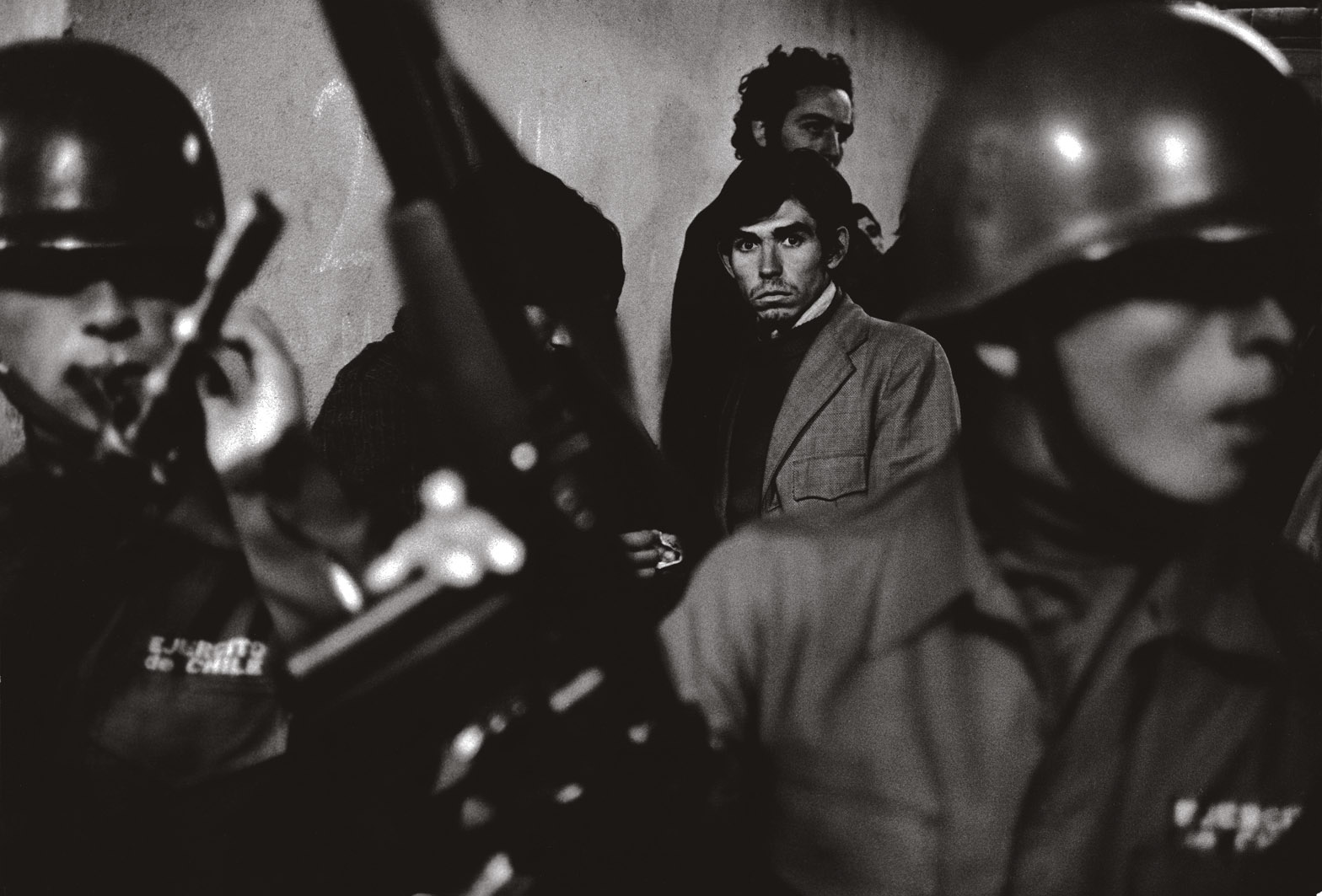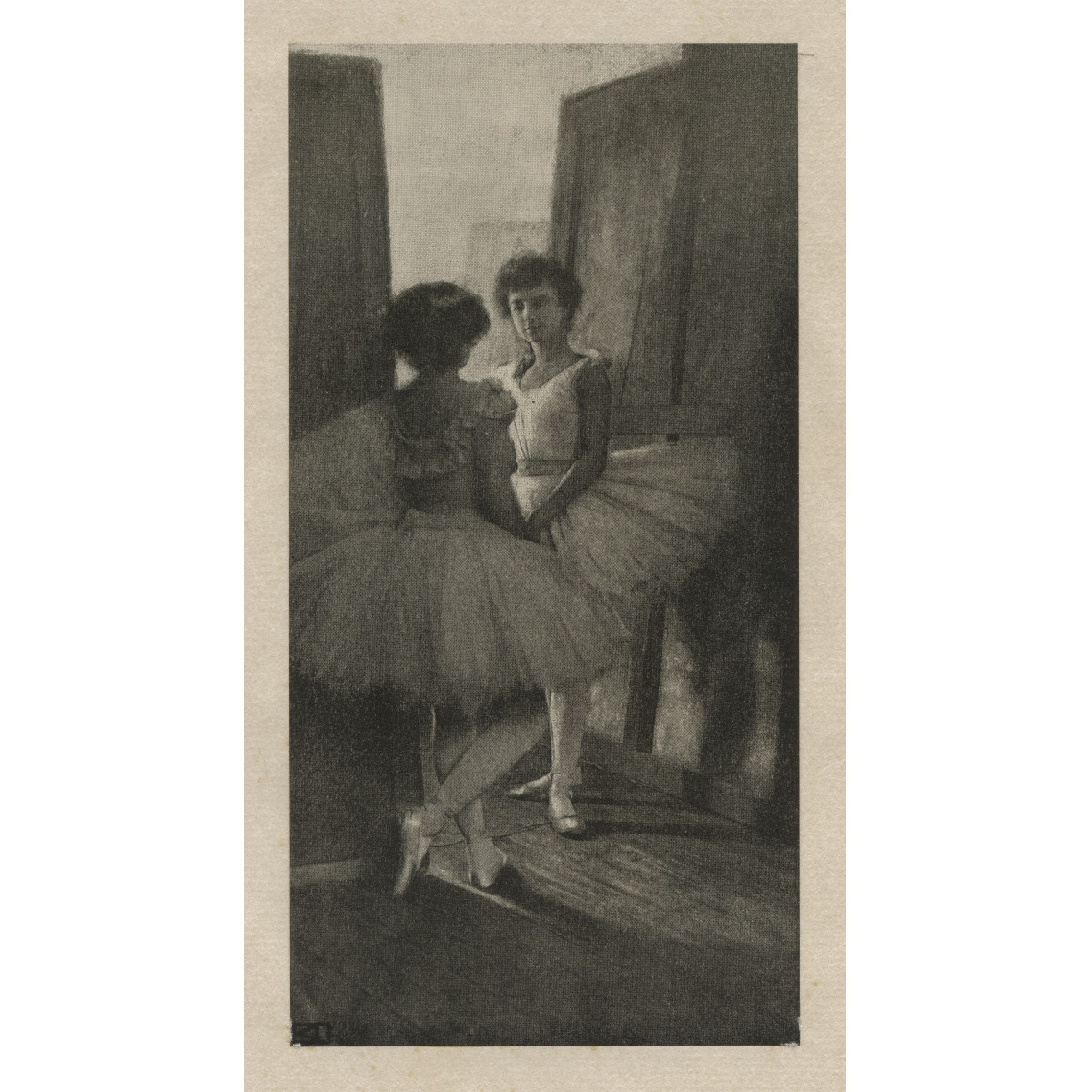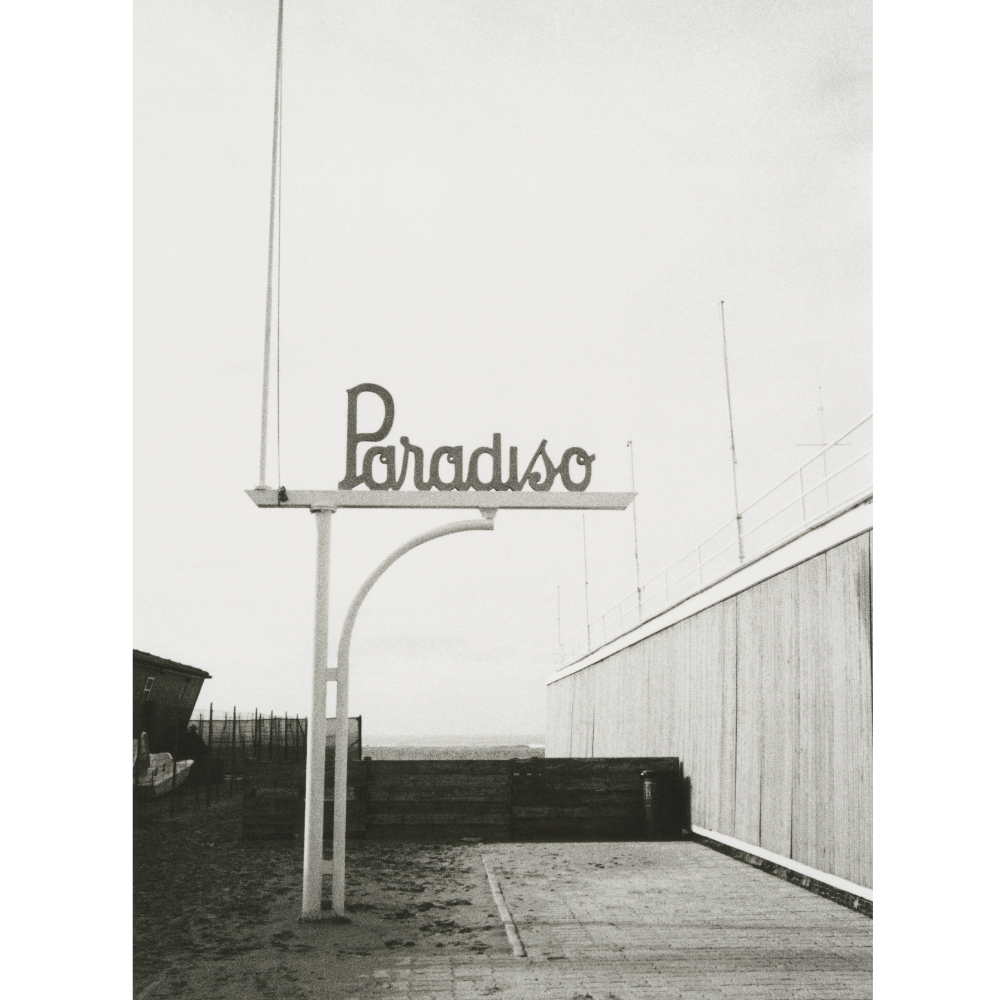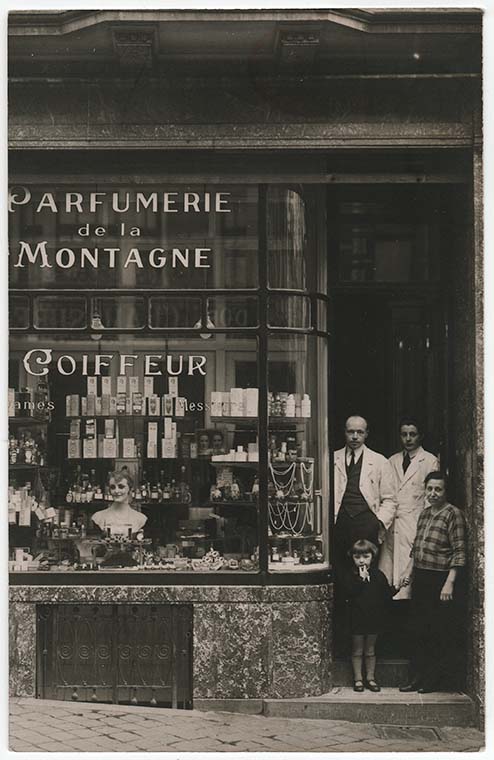L’œuvre du mois de février
Cadrage serré, couleurs denses, lumière intense modulant les formes, tirage carré de grande dimension… autant de caractéristiques qui participent à l’expression esthétique de cette photographie sans divulguer beaucoup de son sujet.



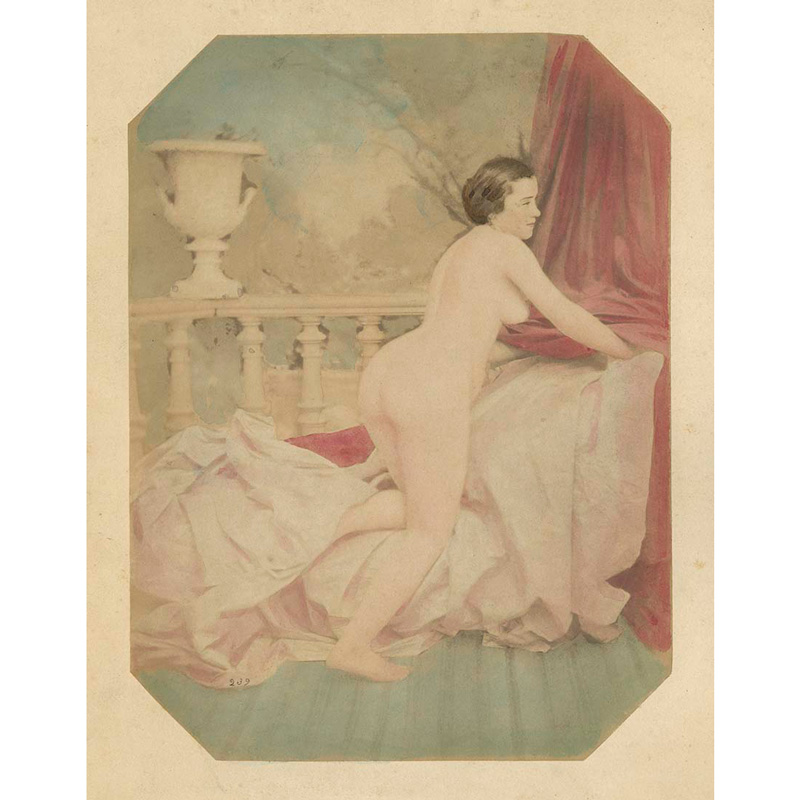

.jpg)